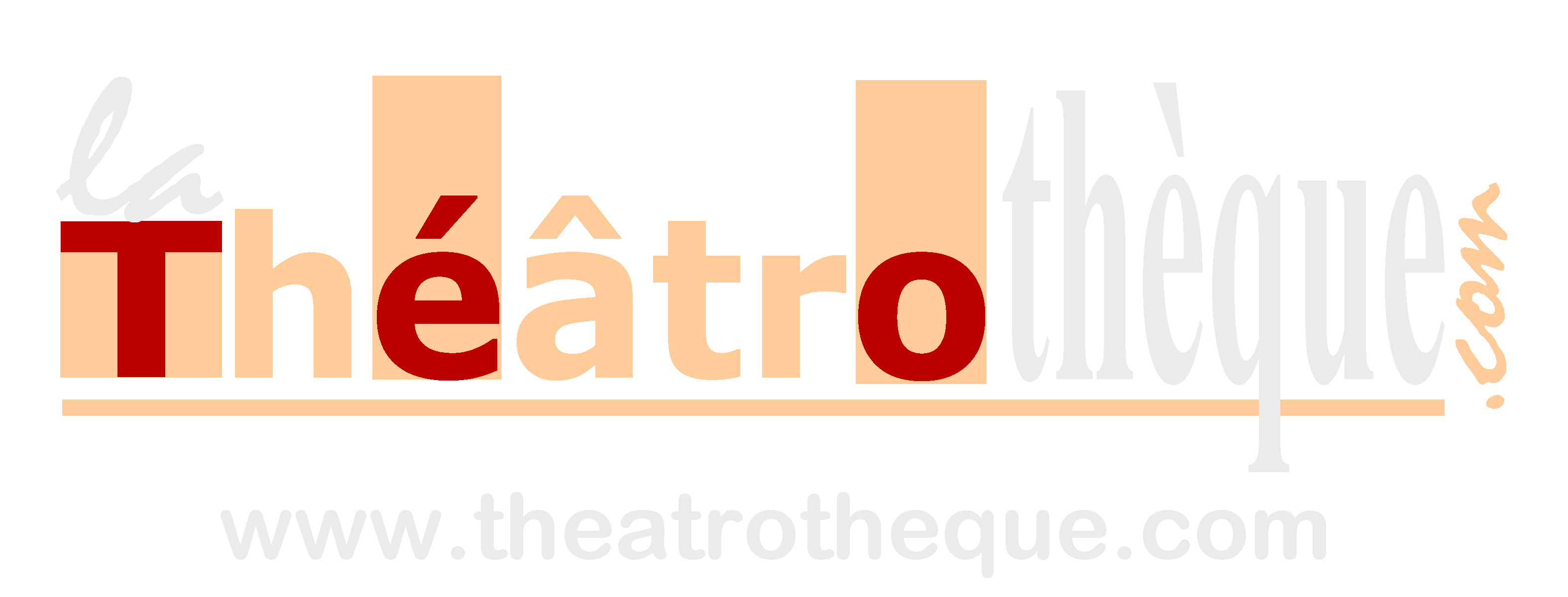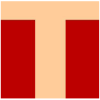Bienvenue sur le nouveau site de La Theatrotheque.com ! Sur votre ordinateur de bureau, votre tablette ou encore votre smartphone, retrouvez désormais votre bibliothèque de textes de théâtre sur tous vos écrans.

La Théâtrothèque.com est le premier site internet francophone répertoriant des pièces de théâtre avec résumés et distribution.
Depuis2000, La Théâtrothèque.com s'adresse aussi bien aux troupes de théâtre à la recherche d'une pièce à monter
qu'aux auteurs souhaitant promouvoir leurs œuvres. D'autres services complètent cette bibliothèque théâtrale en ligne : les petites annonces et des chroniques de spectacles. Autant de rubriques qui
font aujourd'hui de La Théâtrothèque.com un des médias spécialisés dans le théâtre parmi les plus reconnus.

Comédie 5H 4F (ÉVOLUTIF)
La pelle ou la fortune ?
de Alidée Garnier  (Connecté aujourd'hui)
(Connecté aujourd'hui)
Pourquoi ne pas participer à un jeu télévisé en direct ?Peut-être par peur du ridicule ? "Que va t-on penser de moi, si la réponse à la question n'st pas exacte ? Ou pire, si je sèche à une question simple ? Et le stress de tous les regards posés sur soi.Mais l'appât du gain peut-il nous rattraper ? Imaginez-vous, gagner...Comédie 4H 3F
Braquage à la biscotte
de Alidée Garnier  (Connecté aujourd'hui)
(Connecté aujourd'hui)
Un couple apprend par un simple courrier, que madame est l'héritière d'une somptueuse maison qui s'apparente à un château.Une bonne aubaine pour la femme et son mari, qui commence secrètement à avoir des problèmes d'argent.Ce n'est sans interpeller la curiosité de leurs amis, qui se posent beaucoup de questions à...Comédie 2H 0F
Chez Papa, c'est sympa...
de Bertrand Valero  (Connecté aujourd'hui)
(Connecté aujourd'hui)
Après une déception amoureuse un fils homosexuel retourne chez son père divorcé afin de se ressourcer. Cependant il devra faire son coming-out et lui annoncer aussi le fait qu'il a été viré de son travail à cause de ses préférences sexuelles. De son côté, le père, un homme plutôt terre à terre au premier abord, privilégiant la...Sketch, saynète 2H 5F (ÉVOLUTIF)
Tiens-toi droit Totof
de Jean-Luc Pecqueur  (Connecté aujourd'hui)
(Connecté aujourd'hui)
Totof est le neuneu du village… Son avantage, c’est qu’il est très riche… Alors quand sa mère annonce sur l’estrade de la salle des fêtes du petit village, juste avant la séance de théâtre, que Totof voudrait bien trouver une promise… Soudain, les prétendantes se souviennent qu’elles le trouve beau…
Martine, sa mère, en a...Comédie 2H 5F (ÉVOLUTIF)
Nous, on squatte à Neuilly
de Frederic Dugard  (Connecté aujourd'hui)
(Connecté aujourd'hui)
Mylène et François, après deux mois de vacances en camping, rentrent chez eux avec guitare et sacs à dos. Chez eux ? Pas si sûr. Leur modeste appartement est désormais squatté par les De la Rigaudière, une famille très distinguée, prête à défendre ses droits avec l'aide de la police et du voisin.

PARIS
Lucernaire

de Gérard Rauber
Mise en scène de GÉrard Rauber
Ce spectacle musical, orchestré par le génial metteur en scène Gérard Rauber, réunit un quatuor de talents exceptionnels pour nous emporter dans un voyage époustouflant à travers l’univers de Jean-Sébastien Bach ou en rapport à son œuvre comme cet étonnant et pétillant « 12345 »...
L'avis de Yves-Alexandre Julien
Lucernaire

PARIS





 "Come Bach" : Un quatuor virtuose qui réinvente les classiques
"Come Bach" : Un quatuor virtuose qui réinvente les classiques
de Gérard RauberMise en scène de GÉrard Rauber
Ce spectacle musical, orchestré par le génial metteur en scène Gérard Rauber, réunit un quatuor de talents exceptionnels pour nous emporter dans un voyage époustouflant à travers l’univers de Jean-Sébastien Bach ou en rapport à son œuvre comme cet étonnant et pétillant « 12345 »...
L'avis de Yves-Alexandre Julien
PARIS
Lucernaire
"Come Bach" : Un quatuor virtuose qui réinvente les classiques
de Gérard Rauber
Mise en scène de GÉrard Rauber
Lucernaire
"Come Bach" : Un quatuor virtuose qui réinvente les classiques
de Gérard Rauber
Mise en scène de GÉrard Rauber
PARIS
Théâtre Poche Montparnasse
Entre scandale et subtilité : les Diaboliques à la barre
de Christophe Barbier D'Après Jules Barbey D'Aurevilly
Mise en scène de Nicolas Briançon
Théâtre Poche Montparnasse
Entre scandale et subtilité : les Diaboliques à la barre
de Christophe Barbier D'Après Jules Barbey D'Aurevilly
Mise en scène de Nicolas Briançon
PARIS
A la galerie Hélène Aziza
La folle passion de Franz Liszt et Marie D’Agoult
de Pierre Bréant
Mise en scène de Philippe Mercier
A la galerie Hélène Aziza
La folle passion de Franz Liszt et Marie D’Agoult
de Pierre Bréant
Mise en scène de Philippe Mercier