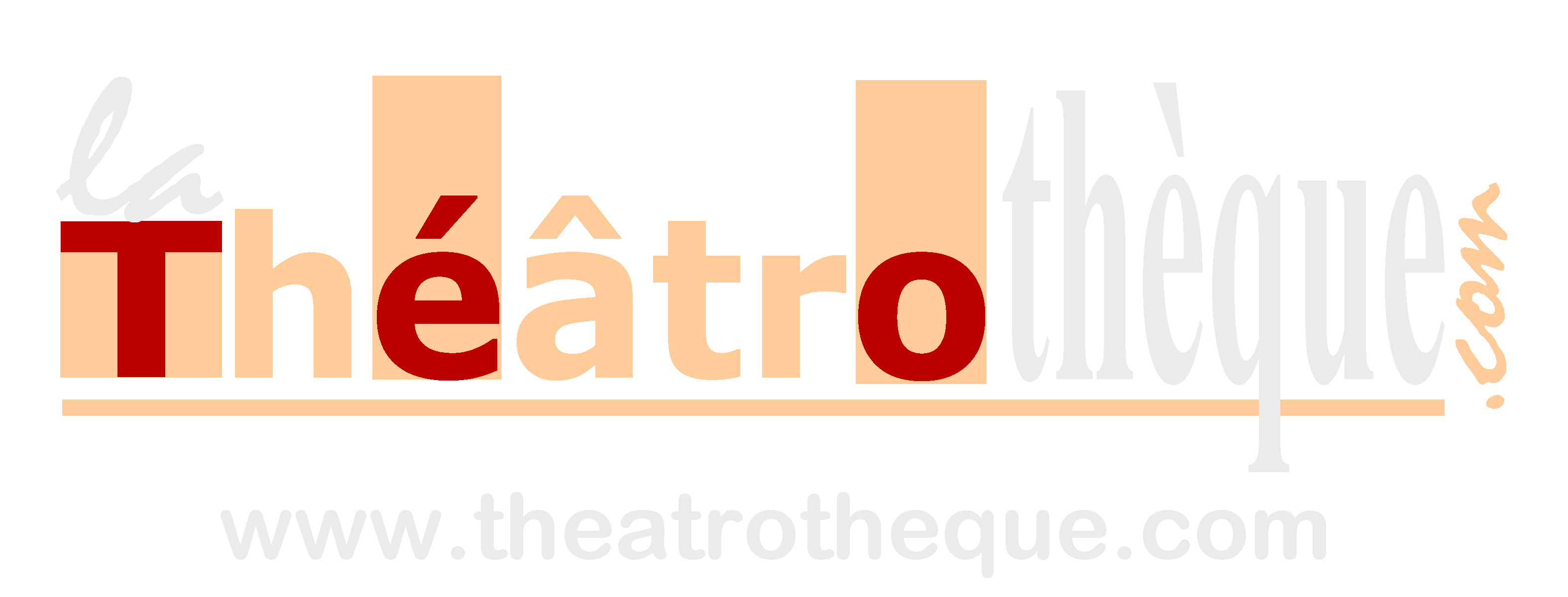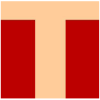Bienvenue sur le nouveau site de La Theatrotheque.com ! Sur votre ordinateur de bureau, votre tablette ou encore votre smartphone, retrouvez désormais votre bibliothèque de textes de théâtre sur tous vos écrans.

La Théâtrothèque.com est le premier site internet francophone répertoriant des pièces de théâtre avec résumés et distribution.
Depuis2000, La Théâtrothèque.com s'adresse aussi bien aux troupes de théâtre à la recherche d'une pièce à monter
qu'aux auteurs souhaitant promouvoir leurs œuvres. D'autres services complètent cette bibliothèque théâtrale en ligne : les petites annonces et des chroniques de spectacles. Autant de rubriques qui
font aujourd'hui de La Théâtrothèque.com un des médias spécialisés dans le théâtre parmi les plus reconnus.

Comédie 4H 5F (ÉVOLUTIF)
Un Assureur rassurant !
de Jean-Luc Pecqueur  (Connecté aujourd'hui)
(Connecté aujourd'hui)
Existe aussi en 5F-4H. - A l’agence MAYCHAULT-SEYTE (trouées ?) Jean prépare secrètement une fête pour l’un de ses meilleurs amis.
C’est du moins ce qu’il raconte à ceux qui veulent bien le croire.
Avec son associée Nadège, ils sont propriétaires du cabinet « Assurences MAYCHAULT-SEYTE ».
Charlotte, sa femme soupçonne...Comédie 5H 6F (ÉVOLUTIF)
Les rescapés de Coco Panda
de Nicolas Marquet  (Connecté aujourd'hui)
(Connecté aujourd'hui)
La 39ème saison de Coco Panda fait revenir les meilleurs candidats des saisons précédentes... Mais l'avidité, les jalousies, les inimitiés de certains vont modifier le déroulement de l'émission.
Drame à l'horizon...Comédie 7H 7F (ÉVOLUTIF)
Le duché de Faye
de Nicolas Marquet  (Connecté aujourd'hui)
(Connecté aujourd'hui)
Au début du XVIIème siècle, un duc prépare sa succession et invite ses amis et sa famille à la signature de son testament. Mais un événement cosmique va venir perturber la soirée ...
Attendez vous à quelques révélations.Comédie 5H 4F (ÉVOLUTIF)
La pelle ou la fortune ?
de Alidée Garnier  (Connecté hier)
(Connecté hier)
Pourquoi ne pas participer à un jeu télévisé en direct ?Peut-être par peur du ridicule ? "Que va t-on penser de moi, si la réponse à la question n'st pas exacte ? Ou pire, si je sèche à une question simple ? Et le stress de tous les regards posés sur soi.Mais l'appât du gain peut-il nous rattraper ? Imaginez-vous, gagner...Comédie 4H 3F
Braquage à la biscotte
de Alidée Garnier  (Connecté hier)
(Connecté hier)
Un couple apprend par un simple courrier, que madame est l'héritière d'une somptueuse maison qui s'apparente à un château.Une bonne aubaine pour la femme et son mari, qui commence secrètement à avoir des problèmes d'argent.Ce n'est sans interpeller la curiosité de leurs amis, qui se posent beaucoup de questions à...

PARIS
Lucernaire

de Gérard Rauber
Mise en scène de GÉrard Rauber
Ce spectacle musical, orchestré par le génial metteur en scène Gérard Rauber, réunit un quatuor de talents exceptionnels pour nous emporter dans un voyage époustouflant à travers l’univers de Jean-Sébastien Bach ou en rapport à son œuvre comme cet étonnant et pétillant « 12345 »...
L'avis de Yves-Alexandre Julien
Lucernaire

PARIS





 "Come Bach" : Un quatuor virtuose qui réinvente les classiques
"Come Bach" : Un quatuor virtuose qui réinvente les classiques
de Gérard RauberMise en scène de GÉrard Rauber
Ce spectacle musical, orchestré par le génial metteur en scène Gérard Rauber, réunit un quatuor de talents exceptionnels pour nous emporter dans un voyage époustouflant à travers l’univers de Jean-Sébastien Bach ou en rapport à son œuvre comme cet étonnant et pétillant « 12345 »...
L'avis de Yves-Alexandre Julien
PARIS
Lucernaire
"Come Bach" : Un quatuor virtuose qui réinvente les classiques
de Gérard Rauber
Mise en scène de GÉrard Rauber
Lucernaire
"Come Bach" : Un quatuor virtuose qui réinvente les classiques
de Gérard Rauber
Mise en scène de GÉrard Rauber
PARIS
Théâtre Poche Montparnasse
Entre scandale et subtilité : les Diaboliques à la barre
de Christophe Barbier D'Après Jules Barbey D'Aurevilly
Mise en scène de Nicolas Briançon
Théâtre Poche Montparnasse
Entre scandale et subtilité : les Diaboliques à la barre
de Christophe Barbier D'Après Jules Barbey D'Aurevilly
Mise en scène de Nicolas Briançon
PARIS
A la galerie Hélène Aziza
La folle passion de Franz Liszt et Marie D’Agoult
de Pierre Bréant
Mise en scène de Philippe Mercier
A la galerie Hélène Aziza
La folle passion de Franz Liszt et Marie D’Agoult
de Pierre Bréant
Mise en scène de Philippe Mercier